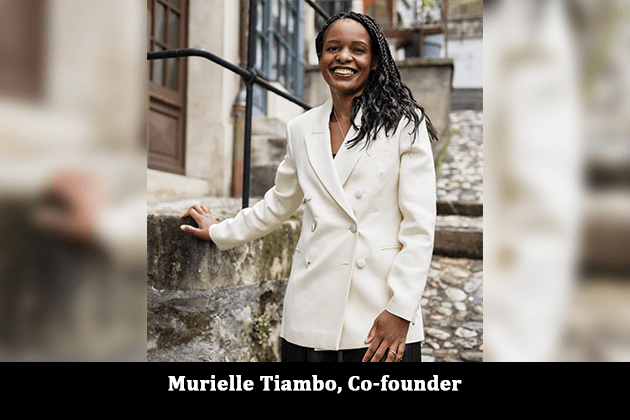Aujourd’hui, un grand nombre de femmes sénégalaises accouchent à domicile, dans des conditions extrêmement difficiles. La conséquence à cela est le fait que le taux de mortalité néonatale est non négligeable et tourne autour de 35%. Mais alors, comment améliorer les conditions de ces femmes pour qui donner naissance peut être fatale ? Comment favoriser la prise en charge de l’accouchement au Sénégal ? Découvrons ensemble la réalité de cette situation alarmante ainsi que les solutions pour changer la vie de ces millions de sénégalaises.
Quelles sont les conditions d’accouchement au Sénégal ?
L’accouchement est une période de la vie vécu différemment dans des pays comme le Sénégal. Si certaines se conviennent d’un accouchement réalisé à l’hôpital, d’autres restent encore attachées à des méthodes plus traditionnelles : l’accouchement à domicile.
Bien entendu, on retrouve une utilisation de cette méthode principalement dans les zones rurales, loin de tout institut de soins médicaux.
C’est la qu’une problématique se pose. Dans les zones rurales, les postes de santé sont plus rares et seulement 30% d’entre eux n’ont pas de sage-femmes. De plus, beaucoup n’ont pas de quoi offrir des soins néonataux basiques, tels que les antibiotiques ou de quoi traiter les éventuelles infections ou complications.
L’accouchement moderne au Sénégal a fait des progrès considérables grâce à la mise en place de politiques publiques ambitieuses, comme la Couverture Maladie Universelle (CMU).
Cette initiative permet désormais à toutes les femmes sénégalaises, en particulier celles dont l’état de santé ou celui du fœtus nécessite une intervention chirurgicale, d’avoir accès à des soins obstétricaux de qualité, notamment la césarienne.
La césarienne est pratiquée dans plusieurs situations, telles que les césariennes obligatoires, les césariennes de nécessité et celles de prudence. Ces types de césariennes sont réalisées lorsque des complications surviennent pendant la grossesse ou l’accouchement, nécessitant une intervention rapide pour préserver la santé de la mère et de l’enfant.
Avec l’implémentation de la Couverture Maladie Universelle, l’accès à la césarienne est devenu plus équitable. Les soins associés, y compris l’acte opératoire, le bilan pré-opératoire, ainsi que les médicaments et produits nécessaires, sont désormais gratuits dans les structures de santé publiques du pays.
Ces structures incluent les hôpitaux, les centres de santé, ainsi que les SONU (Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence) et autres établissements de santé avec un bloc opératoire.
Au Sénégal, le pourcentage de naissances qui ont lieu dans des structures de santé a considérablement augmenté, de plus de 50% depuis 20 ans. Cependant, il faut noter que plus de 40% des sénégalais accouchent encore à domicile et sont exposées à des risques de santé.
Quels sont les défis rencontrés par les femmes sénégalaise à l’accouchement ?

Un respect des traditions qui impacte la santé de la mère et de l’enfant
L’accouchement, au Sénégal, fait partie intégrante des coutumes et traditions des différentes ethnies, car il est perçu comme essentiel à la survie et à la continuité de la communauté.
Au fil des siècles, les sociétés sénégalaises ont développé des rituels et des croyances autour de la grossesse et de l’accouchement, souvent issus de l’observation de la nature et de la création de mythes. Ces pratiques ancestrales reposent sur des rites de protection, des interdits et des symboles visant à assurer la sécurité des mères et de leurs enfants.
Dans les régions les plus éloignées du pays, l’accouchement traditionnel se déroule parfois dans des conditions très rudimentaires.
De nombreuses femmes accouchent dans des toilettes situées à l’arrière des maisons, souvent en pleine vue, sans protection, ni couverture. Ce mode d’accouchement s’inscrit dans une tradition de proximité et de soutien, mais demeure, à certains égards, un défi en termes de conditions sanitaires.
Dans le contexte de l’accouchement au Sénégal, la naissance à l’hôpital, bien qu’elle offre un sentiment de sécurité grâce à l’encadrement médical et aux équipements, peut aussi être perçue comme un déracinement pour certaines femmes.
En effet, pour celles qui sont habituées aux rites et traditions de l’accouchement à domicile, l’hôpital représente un cadre qui ne permet pas toujours de respecter les pratiques culturelles ancrées dans la société sénégalaise.
Le problème qui se pose, c’est que dans certains cas d’accouchement à domicile, le risque d’hémorragie est plus que certain.
Une distance bien trop importante pour les sénégalaise enceintes…
Si de nombreuses femmes prennent l’initiative d’accoucher à domicile au Sénégal, d’autres n’ont pas le choix et ne peuvent se permettre d’adopter des méthodes plus moderne d’accouchement à l’hôpital.
Aujourd’hui, les hôpitaux et organisme de santé restent très éloignés des zones rurales où chaque année, des millions de femmes sénégalaises doivent donner la vie. Mais ce n’est pas là la seule problématique qui s’impose.
L’histoire tragique de Madeleine Ngom en 2020 illustre de manière poignante les défis liés à l’accès aux soins de santé dans les zones rurales du Sénégal.
Moins de trois jours après l’instauration d’une circulaire du ministre de la Santé et de l’Action sociale, visant à améliorer la prise en charge des urgences, Madeleine, une femme du village de Baback, perd la vie après avoir donné naissance à des jumeaux à Sanghé.
Madeleine a accouché dans son village, assistée par les sages-femmes locales. Son accouchement s’est initialement déroulé sans complications, mais elle a commencé à présenter des signes de complications, avec des saignements abondants. Malgré la situation d’urgence, l’accès à l’hôpital régional de Thiès, qui aurait pu sauver sa vie, s’est avéré être un véritable parcours du combattant.
Faute de moyens pour payer l’ambulance, ses proches ont dû improviser, empruntant un véhicule privé pour l’évacuer. Mais le premier véhicule est tombé en panne en chemin, et le second ne tardera pas à connaître le même sort.
Coincés dans les embouteillages à l’entrée de Thiès, ils n’ont pas pu obtenir de passage prioritaire malgré leurs appels désespérés. En l’absence de l’ambulance médicale, l’arrivée de Madeleine à l’hôpital a été fatale.
Une étude a permis de calculer le temps de transport minimum des depuis chaque structure de soins primaires jusqu’à la structure la plus proche réalisant des césariennes : “des structures rurales sont situées à plus de 47 minutes en voiture de la structure pratiquant des césariennes la plus proche, et 37% a plus d’une heure de trajet“.
C’est un temps de transport indécent qui peut mettre en danger la vie des femmes et de leurs bébés.
… et un coût financier que peu de sénégalaises peuvent se permettre pour accoucher
L’histoire de Madeleine, que des millions de sénégalaises vivent chaque année, illustre une seconde réalité accablante : le coût de l’ambulance.
À Sanghé par exemple, pour pouvoir bénéficier des services d’une ambulance du poste de santé, les villageois doivent débourser 10 000 Fcfa (soit environ 15 dollars), une somme que beaucoup ne peuvent pas se permettre.
Face à cette réalité économique, certains habitants sont contraints de recourir à des moyens de transport moins appropriés, comme des taxis, pour déplacer les malades ou les femmes en travail…
… Quant à d’autres, elles doivent se résoudre aux conséquences parfois fatales de l’accouchement à domicile.
Quelles mesures pour améliorer la prise en charge de l’accouchement au Sénégal ?

Aujourd’hui, il est évident que de nombreuses femmes sénégalaises peinent à vivre leur grossesse comme il se doit. L’accouchement peut devenir terrifiant et pourtant, des solutions sont possibles.
Au Sénégal, la santé maternelle a fait l’objet de réformes significatives visant à améliorer les conditions d’accouchement et à réduire la mortalité maternelle et infantile.
Le Plan Stratégique National Intégré de Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, Infantile et des Adolescents/Jeunes (PSN SRMNIA 2016-2020) a été élaboré pour renforcer les services de santé maternelle et néonatale.
Ce plan met l’accent sur l’amélioration de la qualité des soins, l’accès universel aux services de santé et la réduction des inégalités entre les zones urbaines et rurales. Il s’appuie sur des principes directeurs tels que l’engagement national, l’approche intégrée et le respect des droits humains.
Parmi les mesures phares, la gratuité de l’accouchement et des césariennes dans les structures de santé publiques a été instaurée. Cette politique vise à éliminer les barrières financières à l’accès aux soins obstétricaux, en particulier pour les populations vulnérables.
Les hôpitaux, centres de santé et autres établissements de santé avec bloc opératoire offrent désormais ces services sans frais, contribuant ainsi à une augmentation de la fréquentation des structures sanitaires pour les accouchements.
Malgré des améliorations notables des indicateurs de santé maternelle et infantile au Sénégal ces dernières années, le pays demeure encore en deçà des objectifs fixés par les Nations Unies dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Dans certaines régions du pays, notamment Louga, Kolda et Sédhiou, la situation demeure particulièrement préoccupante. La prise en charge des grossesses à risque et des accouchements compliqués est gravement insuffisante, en raison de l’absence d’infrastructures sanitaires adéquates et du manque de personnel médical qualifié.
Comment envoyer des soins à ses proches au Sénégal ?
Si de nombreuses infrastructures doivent être améliorer, toujours est-il que certaines actions peuvent être réalisées même malgré la distance qui sépare les pays.
Aujourd’hui, beaucoup de familles partie vivre ailleurs peinent à aider leurs proches restés au pays. Pourtant, un accès aux soins pré-nataux, des analyses de suivi de grossesse, et même des ressources financières pour que les femmes puissent accéder à une ambulance en cas d’urgence est possible.
Désormais, des solutions innovantes comme KimboCare offrent un moyen pratique et sécurisé pour soutenir vos proches et envoyer ou recevoir de l’argent au Sénégal.
Grâce à cette plateforme, il est désormais possible d’assurer à vos proches l’accès à des soins de santé de qualité sans se soucier des incertitudes liées aux transferts d’argent traditionnels.
Avec KimboCare, vous pouvez acheter des crédits de santé prépayés destinés à des services médicaux spécifiques pour vos proches au Sénégal.
En quelques clics, vous désignez vos proches comme bénéficiaires, garantissant un accès immédiat aux soins nécessaires comme un traitement d’antibiotiques, un séjour d’hospitalisation, un accompagnement par une sage-femme au moment de l’accouchement ou même un suivi de grossesse par des professionnels.
Chaque crédit que vous envoyez est directement utilisé pour des services de santé, offrant ainsi une garantie quant à l’affectation des fonds.
Nous collaborons avec des partenaires médicaux rigoureusement sélectionnés à travers le pays, ce qui permet de s’assurer que vos proches bénéficient du meilleur des soins, sans frais cachés ni délais d’attente.
Une fois l’envoi effectué, vos proches reçoivent une notification leur indiquant les prestataires de soins à contacter, facilitant ainsi un accès fluide et rapide aux services médicaux dont ils ont besoin.
FAQ
1. Quelles sont les principales causes de mortalité maternelle et infantile au Sénégal ?
Au Sénégal, les taux de mortalité maternelle et infantile sont élevés, bien que des progrès aient été réalisés. Les principales causes incluent les complications liées aux grossesses à risque, les infections néonatales et la difficulté d’accès aux soins de santé, notamment dans les zones rurales. La mortalité néonatale, souvent due à des complications durant les premières 24 heures ou le premier mois de vie, reste préoccupante, représentant une grande partie des décès infantiles.
2. Pourquoi de nombreuses femmes accouchent-elles à domicile au Sénégal ?
De nombreuses femmes sénégalaises, surtout dans les zones rurales, choisissent d’accoucher à domicile en raison du manque d’accès aux structures de santé proches, des coûts des soins médicaux, et parfois du respect des traditions culturelles. Bien que des progrès aient été réalisés dans l’amélioration de l’accès aux hôpitaux et aux centres de santé, le manque d’infrastructures adéquates et l’éloignement des hôpitaux demeurent des obstacles majeurs à la prise en charge des accouchements dans les établissements de santé.
3. Comment la Couverture Maladie Universelle (CMU) améliore-t-elle la prise en charge des accouchements au Sénégal ?
La CMU permet aux femmes enceintes d’accéder à des soins de qualité sans frais, notamment pour les accouchements et les césariennes, qui sont maintenant gratuits dans les structures de santé publiques. Cette politique vise à réduire les inégalités en matière de santé et à garantir à toutes les femmes sénégalaises, même dans les zones reculées, un accès équitable aux soins obstétricaux et néonataux.
4. Quelles mesures le gouvernement du Sénégal a-t-il prises pour réduire la mortalité maternelle ?
Le gouvernement sénégalais a mis en place le Plan Stratégique National Intégré de Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, Infantile et des Adolescents/Jeunes (PSN SRMNIA), qui vise à améliorer la qualité des soins, renforcer l’accès aux services de santé et réduire les inégalités entre les zones urbaines et rurales. Des mesures comme la gratuité de l’accouchement, la formation du personnel médical et l’amélioration des infrastructures de santé ont contribué à la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile.
5. Comment envoyer des soins médicaux à mes proches au Sénégal ?
Aujourd’hui, il est possible d’aider vos proches à accéder à des soins de santé de qualité au Sénégal, même si vous vivez à l’étranger. Grâce à des solutions innovantes comme KimboCare, vous pouvez envoyer de l’argent destiné à des soins médicaux spécifiques, tels que des consultations, des traitements antibiotiques, ou un suivi de grossesse. KimboCare permet de garantir que les fonds envoyés sont utilisés directement pour des services de santé, offrant une alternative pratique et sécurisée pour soutenir vos proches dans leur accès aux soins.
6. Quels sont les risques liés aux accouchements dans des conditions précaires ?
Les accouchements dans des conditions précaires, notamment dans des zones rurales où l’accès aux soins est limité, présentent un risque élevé de complications, telles que les hémorragies, les infections et l’absence de soins néonataux appropriés. Ces risques sont exacerbés par le manque de moyens pour atteindre rapidement une structure de santé en cas d’urgence, ce qui peut rendre les accouchements à domicile particulièrement dangereux pour la mère et l’enfant.
7. Comment les transports influencent-ils les chances de survie en cas de complications à l’accouchement au Sénégal ?
Le temps de transport vers les structures médicales est un facteur déterminant dans la survie des femmes enceintes et des nouveau-nés en cas de complications. Dans certaines régions du Sénégal, il peut falloir plus de 45 minutes pour atteindre un établissement de santé capable de réaliser des césariennes, et ce temps de transport, souvent effectué dans des conditions précaires, peut être fatal pour la mère ou l’enfant si les soins nécessaires ne sont pas reçus rapidement.